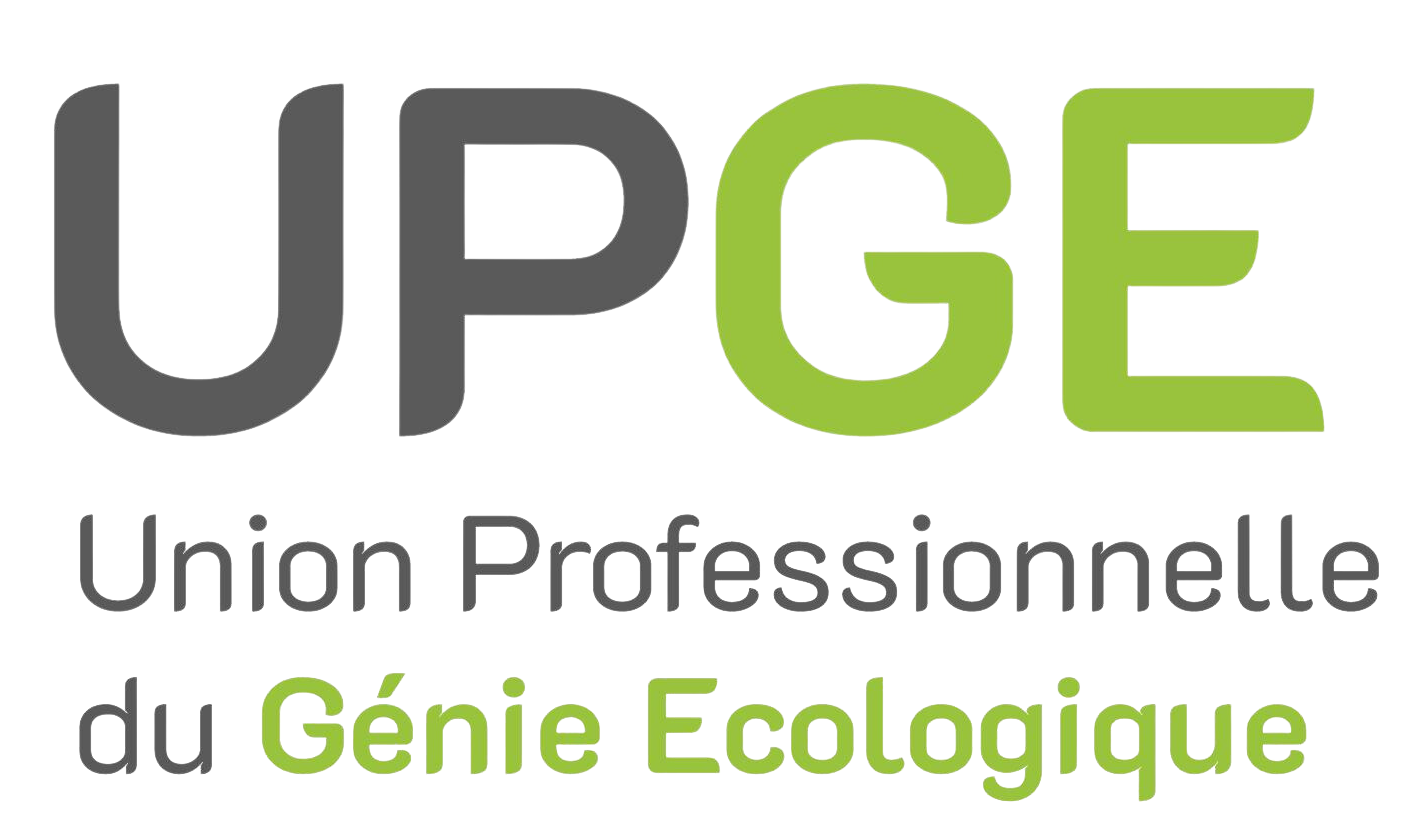Photovoltaïque et pollinisateurs : des synergies possibles ?
Le déclin des insectes pollinisateurs est un sujet sensible largement évoqué dans les médias. Depuis 5 ans, la Société ETCEE TERRA, par l’intermédiaire de sa filiale CERMECO, bureau d’études en écologie, a mis en place un programme de recherche appliquée au sein de plusieurs parcs photovoltaïques, en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Objectifs :
- évaluer les effets de ces projets sur les abeilles sauvages,
- améliorer les recommandations formulées dans les études d’impact,
- conseiller pour une gestion des sites respectueuse de la biodiversité.
Parmi les Hyménoptères, on dénombre 983 espèces d’abeilles sauvages en France métropolitaine (*). La Liste rouge européenne en décrit plus de 9% comme menacées d’extinction. Pourtant, ces insectes jouent un rôle majeur en pollinisant 80% des plantes à fleurs.
Par souci d’amélioration des connaissances et avec la volonté de parfaire les recommandations dans le cadre des études d’impact en amont de la réalisation des projets d’énergies renouvelables, la Société ETCEE TERRA, par l’intermédiaire de sa filiale CERMECO, a lancé il y a 5 ans, un programme d’études qui s’est enrichi en 2022 d’un partenariat avec le Centre de Recherche sur la Biodiversité et l’Environnement et le CNRS de Toulouse.
Ce programme de suivi des populations, mené sur quelque 9 parcs photovoltaïques situés en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, a été complété par la mise en place d’expérimentations d’aménagements, permettant aujourd’hui d’émettre de premières recommandations essentielles pour encourager leur présence sur ces zones aménagées.
Une amélioration des habitats grâce à des actions mécaniques
La majorité des espèces d’abeilles sauvages sont terricoles et nichent directement dans le sol. Sur les parcs concernés par l’étude, un des premiers constats réalisés par les équipes de terrain a été la forte compaction des sols entre les rangées de panneaux après les travaux d’implantation, en particulier dans les parcs en zones anthropisées. En réponse, des bandes de sol ont été décompactées sur une vingtaine de centimètres, à l’aide d’une mini-pelle mécanique.



Avant décompactage du sol.

Après décompactage du sol.
L’année suivant la décompaction, aucune nidification d’abeilles terricoles n’a été constatée sur ces zones. Mais cette action mécanique a favorisé à N+1 un développement plus important de la flore. Si la dynamique de diversité et d’abondance se poursuit, la décompaction peut-être une solution pour améliorer les fonctionnalités des parcs photovoltaïques peu végétalisés en termes de ressources alimentaires des pollinisateurs.
Dans la même logique, des bacs de sable de différents substrats et profondeurs ont été aménagés dans différentes zones des parcs photovoltaïques. Bien que les abeilles sauvages ne s’y soient pas encore installées à N+1, ces structures ont eu des effets bénéfiques sur l’entomofaune en accueillant la reproduction d’autres espèces comme des guêpes fouisseuses et des orthoptères. La terre déblayée pour creuser les bacs de sable a été valorisée sous forme de talus, créant ainsi de potentiels lieux de nidification favorables aux espèces préférant un sol terreux à relief.
Des clôtures ont été installées autour des bacs aménagés, afin d’empêcher les troupeaux pâturant sur site de piétiner d’éventuels nids

Bac de sable (avec clôture) et talus en arrière-plan.
Trois leviers simples pour des parcs photovoltaïques plus favorables à la biodiversité
Le programme de suivi des pollinisateurs sur les parcs photovoltaïques ainsi que sur d’autres types d’infrastructures mené par CERMECO permet de mettre en avant les bonnes pratiques suivantes :
- Favoriser le développement d’une végétation spontanée et locale. Sur les parcs peu végétalisés ou dominés par des espèces herbacées, l’ensemencement apporte un complément de ressource alimentaire significatif à condition de privilégier la flore locale. Les cultivars ornementaux sont à proscrire car souvent pauvres en nectar, et les espèces d’abeilles locales ne sont pas adaptées aux végétaux exotiques. Des floraisons échelonnées du printemps à l’automne permettent aux abeilles de se nourrir toute l’année.
- Adopter une gestion différenciée. Le fauchage tardif et une gestion écologique du site contribuent à préserver les habitats de nidification, notamment pour les espèces utilisant les tiges sèches ou le bois mort. En cas d’entretien par pâturage, il est essentiel de clôturer les zones d’aménagement (décompactage du sol ou bac de sable) pour éviter le piétinement
- Maintenir des zones de sol nu. Les surfaces dégagées (terre ou sable) sont essentielles pour la nidification des abeilles terricoles. Ces aménagements peuvent être intégrés sans nuire à l’exploitation du parc, en périphérie des panneaux dans des zones de délaissé ou entre les rangées.<
Une intégration progressive dans les pratiques d’aménagement et d’entretien
Les premiers résultats de ce programme démontrent que certains aménagements peuvent améliorer les capacités d’accueil des parcs photovoltaïques pour les pollinisateurs.
En poursuivant les suivis dans le temps, l’objectif est de déterminer les leviers les plus efficaces. Car favoriser les pollinisateurs, c’est renforcer la résilience écologique des territoires face aux pressions croissantes dues aux activités humaines.
(*) dernière actualisation de février 2025

Pour aller plus loin :
Vidéo : Les insectes pollinisateurs, comment les préserver efficacement ?